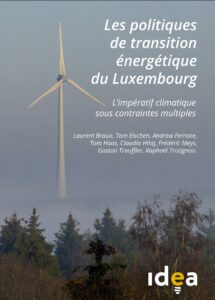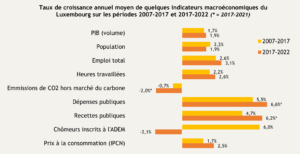© photo : Istock
Les primes actuelles à l’électromobilité[1] fonctionnent mais doivent s’accompagner de mesures plus ambitieuses pour accélérer l’électrification du parc automobile.
Cette analyse met en lumière l’efficacité réelle des politiques d’incitation à l’électromobilité au Luxembourg, ainsi que les défis à relever pour atteindre l’objectif fixé par le Plan national énergie-climat (PNEC) : parvenir à un parc composé à 49% de véhicules électriques et hybrides rechargeables d’ici 2030. Malgré un contexte favorable et des primes substantielles, la dynamique actuelle ne permettrait pas d’atteindre la cible fixée.
Le Luxembourg bien positionné en Europe, mais loin de la trajectoire du PNEC
Le Luxembourg figure pourtant dans le groupe de tête européen en matière de ventes de véhicules électriques. Cette position s’explique notamment par un parc automobile relativement jeune, un pouvoir d’achat élevé, une forte proportion de véhicules de société et une bonne infrastructure de recharge.
Pour autant, la part des voitures électriques dans le parc reste limitée : 11,6% en mai 2025, et la progression récente des immatriculations marque un ralentissement. L’étude confirme que les objectifs liés à la mobilité électrique ne seront pas atteints sans une accélération significative, mobilisant d’autres leviers que les seules incitations financières.
Les aides à l’achat : efficaces, mais leur effet reste limité
L’analyse comparative du coût total de détention de 15 paires de véhicules thermiques et électriques – en achat comme en leasing – révèle des tendances claires :
- Avec les primes actuelles, les voitures électriques sont financièrement plus avantageuses dans 12 cas sur 15, pour un gain moyen de 1.255 € total en 6 ans.
- Sans prime, l’électrique devient plus coûteux dans la quasi-totalité des cas (+4.145 € en moyenne).
- Les prix de l’électricité ou du carburant jouent un rôle secondaire : les fluctuations testées n’inversent que rarement l’arbitrage.
- Le leasing renforce la compétitivité de l’électrique : dans 14 cas sur 15, il est plus avantageux de prendre un leasing électrique plutôt que thermique.
La fiscalité automobile, et notamment la taxe de circulation, est trop faible pour influencer les comportements, avec un différentiel moyen de seulement 50 € par an entre thermique et électrique.
Un rapport coût/bénéfice… élevé
L’étude évalue également l’efficacité climatique des primes à travers la méthode des coûts d’abattement, mesurant le coût par tonne de CO₂ évitée pour la société dans son ensemble (coût global pour l’Etat et avantage pour le consommateur) :
- entre 393 €/tCO₂ (périmètre national sans tenir compte de la fabrication du véhicule),
- et 923 €/tCO₂ (avec empreinte liée à la production hors Europe et prise en compte de l’empreinte environnementale de l’énergie importée).
Ces montants sont nettement supérieurs en comparaison à certains signaux du prix du carbone :
- taxe carbone luxembourgeoise : 40 €/tCO₂,
- prix ETS européen : environ 75 €/tCO₂.
Les primes présentent donc un rapport coût/bénéfice élevé. La méthodologie des coûts d’abattement (et plus généralement de l’analyse des politiques environnementales sous l’angle de leur coût/efficacité) pourrait être appliquée à d’autres politiques afin de créer une base de comparaison utile à la priorisation des politiques de décarbonation.
Des leviers supplémentaires nécessaires
La politique luxembourgeoise est aujourd’hui fortement centrée sur la « carotte », tandis que les mesures dissuasives – largement utilisées ailleurs en Europe – restent limitées.
Plusieurs pistes sont proposées pour accélérer la transition et mériteraient d’être débattues au Luxembourg :
- Introduire un leasing social
Annoncé (et en cours d’analyse) mais pas encore mis en œuvre, il permettrait aux ménages modestes d’accéder à l’électrique sans charge initiale élevée.
- Déduire la prime directement à l’achat
Une mesure simple pour supprimer le frein du préfinancement par l’acquéreur et effacer la barrière psychologique du surcoût au moment de l’achat.
- Déployer des zones à faibles émissions ou un péage urbain modulé
Mesures adoptées dans de nombreuses villes européennes, incitant à abandonner les motorisations polluantes.
- Adapter la fiscalité automobile
Une modulation plus marquée de la taxe de circulation ou l’introduction d’une taxe de mise en circulation écologique renforceraient l’incitation financière.
- Informer davantage sur le coût total de détention
Une meilleure visibilité sur les avantages concrets du passage à l’électrique pourrait réduire certaines perceptions négatives.
Un débat nécessaire sur la mobilité et le rôle de la voiture au Luxembourg
Au-delà de l’électrification, la problématique de la mobilité au Luxembourg est plus globale : congestion, besoins des frontaliers, aménagement du territoire, report modal, qualité de l’air…
L’étude rappelle que réduire la taille du parc automobile – via des primes à la casse, le partage de véhicules ou le développement du transport public – constitue aussi un levier structurant.
Conclusion : poursuivre l’incitation, mais oser les mesures structurelles
L’analyse confirme que les primes actuelles « fonctionnent », mais ne suffisent pas pour atteindre les objectifs climatiques du Luxembourg à horizon 2030. L’analyse des coûts / bénéfices montrent un coût par tonne de CO2 évité important. Cette approche analytique pourrait être reproduite à d’autres politiques afin de comparer leur efficacité entre elles. Enfin, la transition vers l’électromobilité nécessite désormais un équilibre entre incitations, fiscalité adaptée et mesures réglementaires, dans le respect de l’acceptabilité sociale.
[1] A savoir : 6.000 euros pour un véhicule consommant moins de 16kW/h par 100km. Il existe également une prime pour des véhicules consommant davantage mais sous conditions et moins avantageuse.
Consulter en ligne le Document de travail n°34 :
Pour télécharger le Document de travail n°34 “Document de Travail N°34 : Objectifs et efficacité des incitations environnementales, le cas du marché de l’électromobilité au Luxembourg.” :