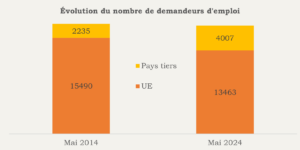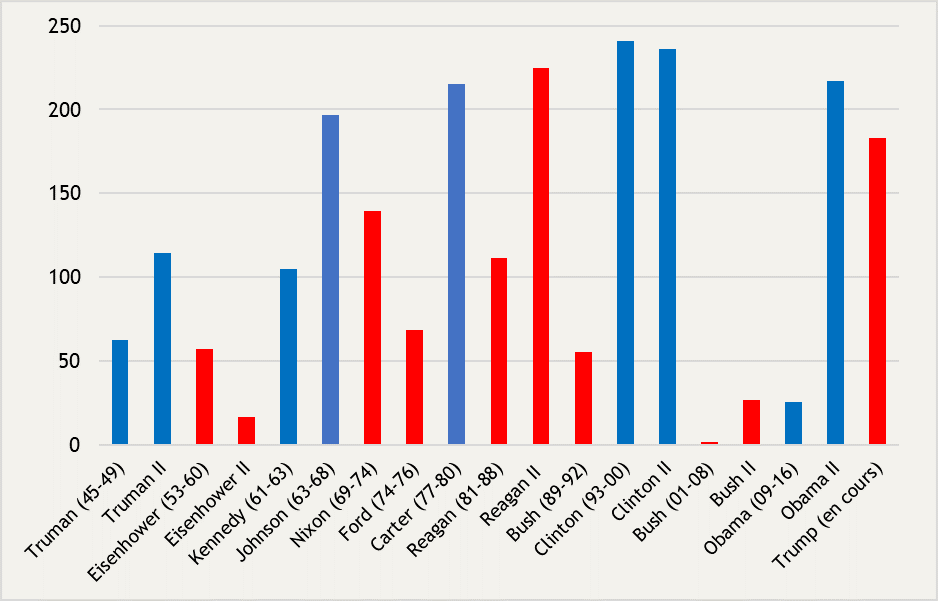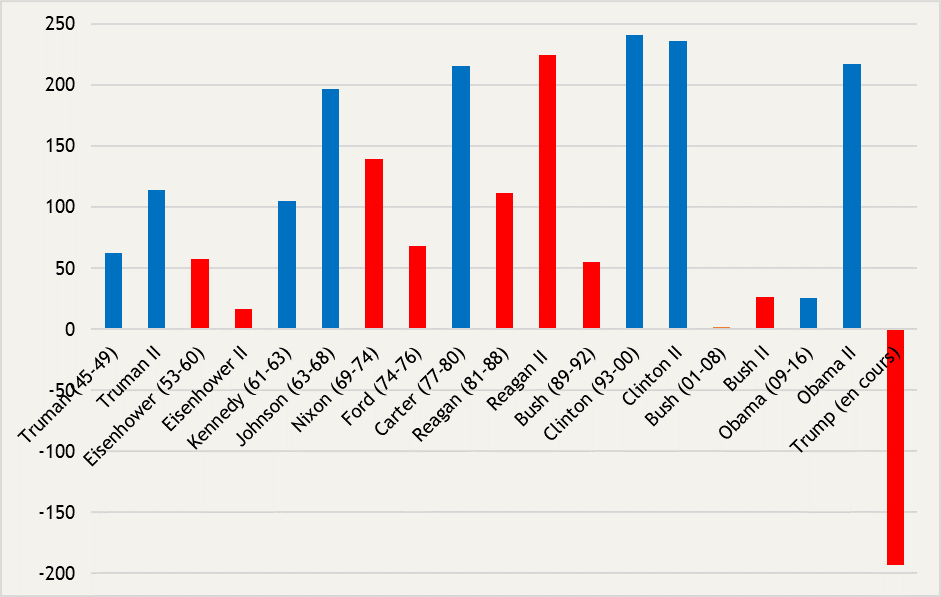© photo : Julien Mpia Massa
Alors que s’ouvre cet automne un débat crucial pour l’avenir du système des pensions, la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté est l’occasion de s’intéresser à l’une des composantes du débat : la pauvreté des seniors. En effet, la protection du niveau de vie des pensionnés aux revenus modestes sera une nécessité si devaient être décidés des changements profonds du système de retraite. Dans la recherche des solutions pour mieux lutter contre la pauvreté des seniors, le niveau de la pension minimale n’est qu’un des nombreux éléments à considérer.
Être pensionné, un bouclier contre la pauvreté ?
Les personnes résidentes au Luxembourg de plus de 60 ans ont la particularité de bénéficier d’un revenu médian supérieur de 12%[1] à celui des habitants de moins de 60 ans. Cette spécificité, quasi-unique en Europe, les protège davantage que les actifs de la pauvreté. De fait, le taux de risque de pauvreté des pensionnés, c’est-à-dire le pourcentage de pensionnés disposant d’un revenu inférieur à 60% du revenu médian dans le pays, était de 10,7% en 2023 contre 17,8% pour l’ensemble de la population. Celui des personnes de plus de 65 ans, pensionnées ou non, atteint 10,5%, en progression importante certes puisque ce taux était égal à 6,2% il y a de cela 10 ans[2]. Les hommes de plus de 65 ans (taux de risque de pauvreté de 9,5%) sont davantage protégés de la pauvreté que les femmes du même âge (11,5%), mais dans des proportions moindres qu’au niveau européen, 18,9% pour les femmes contre 13,9% pour les hommes.
Cette plus grande protection au niveau du revenu est renforcée par la structure des dépenses des pensionnés. Selon le STATEC[3], la part des dépenses pré-engagées[4] n’est que de 29% du budget total des ménages de plus de 60 ans contre 37% pour l’ensemble de la population, ce qui permet à une part importante des seniors de bénéficier d’un pouvoir d’achat favorable, notamment en raison de leur situation vis-à-vis du logement.
Toutefois, ce bouclier n’agirait pas avec efficacité pour tous. Tous les pensionnés ne sont pas propriétaires de leur logement avec un crédit remboursé[5]. Tous ne bénéficient pas d’une pension à taux plein garantissant un niveau de vie satisfaisant. L’intensité de la pauvreté, qui compare la distance du revenu des personnes en risque de pauvreté au seuil de pauvreté, plus élevée chez les personnes de plus de 65 ans[6] que pour l’ensemble de la population concernée est un premier indice illustrant les disparités de situation entre seniors et des failles possibles de la protection sociale.
Des situations diverses et variées
Les inégalités de revenu entre les seniors de plus de 65 ans, que l’on mesure par le rapport interquintile[7], sont quasi-équivalentes au Luxembourg à celles des moins de 65 ans (rapport de 4,63 pour les seniors contre 4,75 pour les moins de 65 ans) contrairement au niveau européen, où les différences se réduisent davantage avec l’âge[8]. Cet écart reflète, en partie, les différences de montant entre pensions minimale et maximale, et est renforcé par les autres revenus potentiels des ménages seniors tels que ceux du patrimoine. En outre, la pauvreté de certains ménages seniors pourrait provenir de revenus de pensions partielles ou d’une absence de pensions. Ceci peut être dû à un parcours discontinu d’assuré au Luxembourg (périodes de chômage non indemnisées, éducation des enfants, entrepreneuriat…) et d’une vie professionnelle en partie passée à l’étranger (avec ou non un système de pensions comparable à celui du Luxembourg dans les autres pays de travail).
Ainsi, le dernier Pension adequacy report[9] précisait que 27 % des retraités résidents ont eu une carrière professionnelle dans plus d’un pays et ne perçoivent donc qu’une pension partielle du Luxembourg (et, pour la plupart d’entre eux, des pensions partielles supplémentaires dans d’autres pays). Selon ce même rapport, le taux de remplacement théorique[10] des salaires par les prestations de pensions était en 2022, pour une personne dont le salaire équivalait aux 2/3 du salaire moyen, de 105,9% pour un départ en retraite après 40 ans de cotisation, de 102,2% pour une personne qui aurait été au chômage pendant trois ans et de 77,1% dans le cas d’une carrière courte de 20 ans.
Selon les dernières données de l’IGSS pour l’année 2022, le Luxembourg comptait 3.252 bénéficiaires du REVIS de plus de 60 ans[11], dont 2.139 de plus de 65 ans[12]. C’est ainsi 2,5% de la population de 60 ans et plus qui bénéficie du REVIS, une population à faible revenu qui est loin de disposer d’une pension minimale complète par personne. Cette situation peut être aggravée par la composition du ménage, 85,5% de la population de 65 ans et plus vivant dans un ménage composé d’un adulte seul ou d’un couple de deux adultes sans autre personne, 14,5% des seniors[13] feraient partie d’un ménage que l’on pourrait qualifier d’atypique (enfant encore à charge, hébergement de parents en situation de dépendance…).
Enfin, impossible au Luxembourg d’aborder le sujet du pouvoir d’achat sans évoquer celui du logement. En 2023, le taux de risque de pauvreté des personnes de plus de 60 ans différait fortement entre les ménages seniors propriétaires (8,6%) et locataires (20,6%). Faiblesse des revenus et coût potentiel du loyer faisaient que 40% des personnes en risque de pauvreté de plus de 65 ans étaient en surcharge des coûts du logement[14] en 2023.
Et comment y répondre
Ces éléments ne constituent qu’une ébauche d’une analyse plus complète à effectuer sur la situation des ménages seniors aux revenus modestes. Configurer les politiques publiques qui permettront de mieux lutter contre la pauvreté des seniors, à l’intérieur et en-dehors du mécanisme assurantiel du système des pensions, requière une radiographie plus précise des situations menant à ces bas revenus, tant du point de vue théorique, analyse des cas, que pratique, études statistiques et de terrain. Devront notamment être examinés la composition du revenu des personnes modestes de 65 ans et plus, les parcours de vie des personnes avec un revenu inférieur à la pension minimale complète ou encore leurs dépenses nécessaires, ce dernier point étant déjà en partie explorée par le budget de référence[15].
Si un tel travail est une nécessité, il est déjà possible d’esquisser quelques pistes à mettre dans le débat public. Au niveau du régime des pensions, la distribution de l’allocation de fin d’année et l’ajustement des pensions aux salaires réels pourraient être davantage pérennisés tout en les ciblant socialement, tandis qu’un crédit d’impôt pension modeste pourrait voir le jour, sur le modèle du crédit d’impôt salaire social minimum. Concernant les politiques de solidarité, la création d’un REVIS vieillesse pourrait être étudiée, sachant que de nombreux pays différencient un revenu minimum vieillesse plus élevé du revenu minimum pour les personnes en âge de travailler. Il en est de même d’une allocation logement qui serait intégrée à la pension (pour les locataires et les propriétaires selon l’exemple finlandais[16]) et de la mise en place de nouveaux services gratuits accessibles à la population âgée comme des chèques activités physiques, culturelles et éducatives.
[1] Eurostat, 2023.
[2] Dans le contexte d’une tendance à la hausse globale du taux de risque de pauvreté au Luxembourg, qui est passé de 15,9% en 2013 à 18,8% en 2023.
[3] Rapport « Travail et cohésion sociale » 2024, STATEC.
[4] Les dépenses « pré-engagées » sont les dépenses que les ménages engagent par un contrat ou un abonnement : dépenses liées au logement (loyer, eau, gaz, électricité…), assurance, télécommunication, cantine…
[5] Catégorie pour laquelle le taux de dépenses pré-engagées n’est que de 23%.
[6] Cette intensité est de 19% pour les personnes de plus de 65 ans en risque de pauvreté, contre 17,2% pour l’ensemble de la population en risque de pauvreté selon le rapport Travail et cohésion sociale 2024 du STATEC.
[7] Le rapport interquintile correspond à la différence de revenu entre la borne supérieure des 20% de ménages les plus modestes et la borne inférieure des 20% de ménages les plus aisés.
[8] Un rapport interquintile de 4,85 pour les moins de 65 ans contre 4,11 pour les plus de 65 ans.
[9] Pension adequacy report 2024 – Current and future income adequacy in old age in the EU, Jointreport prepared by the Social Protection Committee (SPC) and the European Commission (DG EMPL).
[10] Soit le niveau des droits à pension la première année après la retraite, mesuré en pourcentage du salaire individuel de l’année précédente.
[11] 1.807 femmes et 1.445 hommes.
[12] 1.250 femmes et 889 hommes.
[13] Eurostat, 2023.
[14] Ménages dont les coûts totaux de logement (après déduction des allocations de logement) représentent plus de 40 % du revenu disponible (après déduction des allocations de logement).
[15] Le STATEC mène depuis 2016 des travaux sur le budget de référence nécessaire, à partir de l’établissement d’un panier de biens et de services, pour atteindre un niveau de vie « modeste, mais adéquat » selon différents types de ménage. Une des études publiées s’intitule Quels besoins minimums pour les seniors au Luxembourg ? Il est à noter que le budget de référence est établi pour un ménage qui doit supporter le coût d’un loyer.
[16] Il s’agit d’une allocation, comprise dans le montant de la pension, qui est fonction, en Finlande, du revenu du ménage, du loyer ou des coûts d’entretien et charges pour les propriétaires, du lieu de résidence, avec des limites de surface.