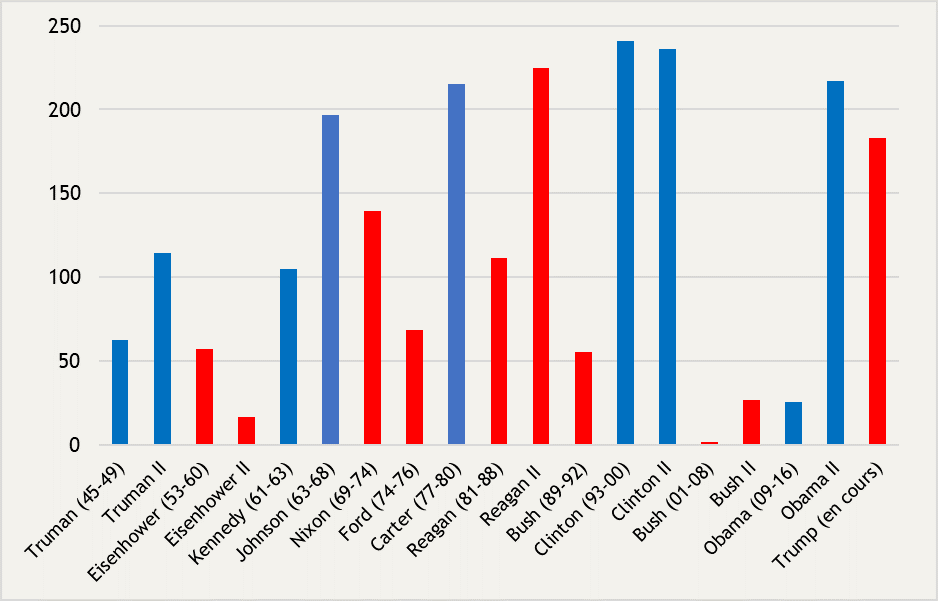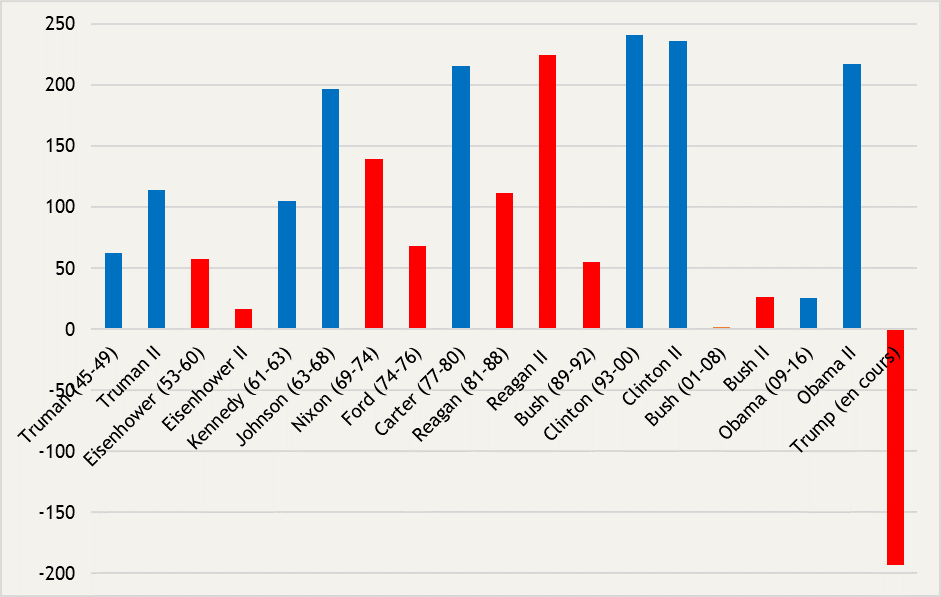A propos de l’auteur :
Denis Ferrand est Directeur Général de Rexecode.
L’accélération des prix à la consommation aux Etats-Unis ravive la perception de l’entrée dans une nouvelle ère de forte inflation. Le choc actuel de prix pourrait toutefois rester contenu et se révéler temporaire. Il ne s’agirait alors que d’un répit, les conditions fondamentales d’un surcroît durable d’inflation semblant se réunir.
Le constat tout d’abord : de décembre dernier à juin, la variation sur un an des prix à la consommation (hors énergie et alimentation) est passée aux Etats-Unis de 1,6 à 4,5 %, un rythme inédit depuis trente ans. La zone euro reste à l’écart de cette bouffée de chaleur, l’indice comparable progressant de moins de 1 % sur un an en juin bien que les prix de nombreuses matières premières aient bondi et que des difficultés d’approvisionnement se répandent en de nombreux maillons de la chaîne de valeur.
La trajectoire à court terme ensuite : les craintes de l’entrée prochaine dans une boucle inflationniste sont à tempérer.
- Ce choc reste spécifique aux Etats-Unis.
- Il y est circonscrit à quelques produits liés à la mobilité des personnes. 82 % de l’accélération survenue lors des six derniers mois est expliquée par seulement cinq produits (voitures d’occasion, véhicules neufs, location de véhicules, assurances de ceux-ci, billets d’avion). Ceux-ci ne représentent que 11 % du panier de consommation des ménages. Les prix des autres produits hors énergie n’accélèrent pas.
- Les anticipations d’inflation à moyen terme formulées par les ménages ont peu réagi voire refluent pour celles formulées sur les marchés financiers.
- Les salaires n’ont pas non plus réagi. Si des pénuries de main d’œuvre se diffusent à de nombreux secteurs, le niveau de l’emploi reste en effet inférieur de 6 millions de personnes (-4,4 %) par rapport à son niveau pré-pandémie. La boucle prix-salaires reste invisible à ce stade.
Au total, ce choc de prix pourrait bien s’apparenter à un pur prélèvement de pouvoir d’achat subi par les ménages américains. Un prélèvement à replacer dans le contexte spécifique de la pandémie : l’an dernier, leur revenu réel s’est accru de 5,9 % alors que le PIB chutait de 3,5 %. Le creusement du déficit public américain est la contrepartie de cet écart.
La trajectoire plus structurelle enfin : si le choc de prix pourrait rester temporaire et s’assagir d’ici fin 2021 ou début 2022, l’installation à moyen terme sur un régime d’inflation plus élevée que lors des vingt dernières années est possible et ce pour trois raisons principales.
La première est que les ingrédients de la « Grande Modération » ont perdu de leur substance. La Grande Modération est l’installation des économies occidentales à partir du début des années 1980 dans un régime de faible inflation. Elle reposait sur une politique monétaire très restrictive à l’origine, une ouverture accrue aux échanges mondiaux parachevée par l’omniprésence chinoise sur la production de biens, des gains de productivité élevés, une désindexation et une forte pression sur les salaires, un recours à l’endettement comme supplétif à la faible progression relative du revenu des ménages… La plupart de ces ingrédients sont désormais caduques : la politique monétaire est tout sauf restrictive, le commerce mondial se rétracte relativement à l’activité depuis 2010, les gains de productivité faiblissent tendanciellement, les pénuries de main d’œuvre redonnent aux salariés un pouvoir de négociation, l’endettement sans frein des ménages a montré ses limites en 2008-09. Le philtre de la Grande Modération s’est évaporé.
La deuxième raison tient à l’impact très discuté des mutations structurelles des sociétés et des économies sur l’inflation. Le vieillissement démographique tout d’abord : parce qu’il conduit une raréfaction relative de l’offre de travail et induit un changement dans la structure de la demande vers des services à forte intensité en main d’œuvre (économie du care), son potentiel inflationniste ne peut être minoré[1]. La transition énergétique ensuite : elle est a priori inflationniste à moins que le progrès technique ne permette d’abaisser rapidement les coûts d’une source d’énergie à faible pouvoir d’émission de CO² alternative aux technologies en place. Par les coûts croissants des dommages environnementaux associés et du coût des assurances pour y faire face, le réchauffement climatique est également inflationniste. La numérisation de l’économie enfin : par une mise en concurrence de producteurs encore élargie, par la réduction des barrières à l’entrée de certaines activités ou encore par les gains de productivité qu’elle promeut, elle est a priori désinflationniste. Toutefois, l’économie numérique propage de puissants effets de réseaux propices à la monopolisation. Des premiers travaux de recherche économique ont également montré que les outils de l’intelligence artificielle pouvaient occasionner des effets de collusion entre algorithmes dans le sens d’une hausse des prix[2]. Les taux de mark-up (soit l’écart entre les coûts globaux et les prix pratiqués) seraient également un peu plus élevés dans les secteurs très numérisés relativement à ceux qui le sont moins[3]. Autant d’éléments plutôt inflationnistes.
La dernière raison tient à la tolérance vis-à-vis de l’inflation : un peu plus de hausse des prix inquiète d’autant moins qu’elle peut être un outil puissant de dévalorisation des dettes anciennes. Un argument de poids au moment où les Etats croulent sous des tombereaux de dette. Le slogan « Pay them more » prononcé récemment par Joe Biden est symptomatique d’une aspiration à un peu plus d’inflation d’autant moins redoutée qu’elle serait perçue comme utile pour les finances publiques… mais au risque d’oublier ses répercussions en termes de pertes de valeur patrimoniale pour des détenteurs de dette, qui sont aussi des électeurs. L’inflation est aussi un enjeu de répartition.
[1] Voir sur ce point la thèse de C. Goodhart et M. Pradhan The great demographic reversal : ageing societies, waning inequalities and an inflation revival, Springer 2020
[2] Voir Calvano et al. 2019 https://voxeu.org/article/artificial-intelligence-algorithmic-pricing-and-collusion
[3] Voir par exemple Calligaris et al. 2018, https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/mark-ups-in-the-digital-era_4efe2d25-en#page1