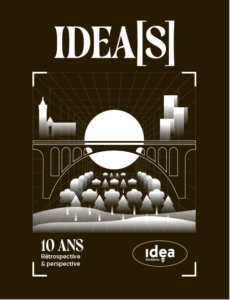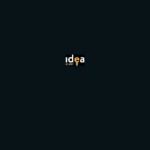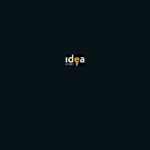© photo : Thierry Nelissen, Tellitweb
Le think tank « IDEA » se positionne comme un laboratoire d’idées qui vise à identifier les grands défis du Luxembourg et à alimenter le débat public par des études et des recommandations aux décideurs publics. L’une des principales forces d’IDEA est d’avoir constitué une équipe d’économistes aguerris dans leur domaine de recherche. Mais les économistes sont-ils les mieux placés pour proposer des solutions à tous les grands défis d’un pays comme le Luxembourg ?
Vincent Hein, directeur d’IDEA et Thierry Labro, rédacteur en chef de Paperjam se sont prêtés au jeu du “pour ou contre” dans le magazine publié à l’occasion des 10 ans d’IDEA. Retrouvez le “contre”, avec Thierry Labro ici : https://www.fondation-idea.lu/2025/01/07/pour-ou-contre-les-economistes/
[Pour]
Les économistes ne doivent pas être idéalisés. Mais ils sont loin d’être les plus mal placés pour contribuer à l’élaboration des politiques publiques et à la bonne marche de la démocratie.
L’économie est une science qui a pour mission d’étudier la manière dont nous, les humains, nous organisons (ou devrions le faire) pour répondre à notre aspiration aussi immorale que naturelle à vouloir disposer de toujours plus de biens et de services tout en tenant compte du fait que notre capacité à y accéder est limitée par de multiples contraintes. N’est-ce pas là une synthèse honnête de ce qu’est la fonction objective d’une organisation sociale ?
Etudier comment les individus se comportent, comment les organisations se structurent et prennent des décisions en considérant systématiquement cette équation entre aspirations illimités et ressources rares permet de nous éloigner de l’inflexion « populiste » dans la conduite des politiques publiques qui consisterait à promettre (voire pire, à croire) l’impossible en oubliant les contraintes. Cette trame d’analyse facilite aussi l’appel à la responsabilité environnementale, l’économie étant la « science de la gestion des ressources rares », qui porte d’ailleurs en soi de multiples influences disciplinaires (histoire, gestion, droit, sociologie, psychologie, etc.).
Une recherche économique bien encadrée, c’est-à-dire (entre autres choses) dont le commanditaire ou l’auteur n’a pas en tête les conclusions au moment de l’établissement des hypothèses, permet toujours de donner des éléments utiles aux décideurs, d’exprimer dans des grandeurs comparables les coûts et les bénéfices, les risques et les opportunités… Cela est également valable lorsqu’une évaluation d’impact conclut que « l’on ne sait pas », cela revenant à admettre que la décision reste purement politique. Un constat rassurant pour la démocratie.
Les travaux des économistes permettent d’objectiver ou de contrer des intuitions et de ne pas transformer des évidences anecdotiques en lois. Se poser la question de l’utilité des économistes revient à se demander si l’on peut sereinement diriger une organisation, qu’il s’agisse du ménage planifiant sa retraite ou du ministre de la Famille souhaitant réduire la pauvreté infantile… sans mesurer ? S’il est préférable de prendre des décisions sans données quand elles existent, alors les économistes ne sont pas utiles !